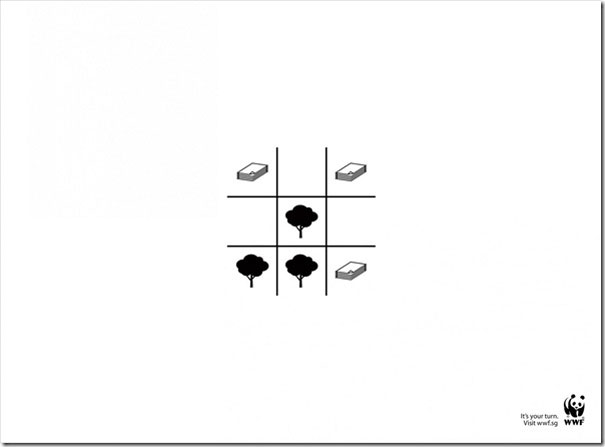On apprenait récemment que le célèbre Manneken-Pis de Bruxelles, qui sert de fontaine publique depuis des siècles (au moins depuis 1695, voire 1388 selon certaines archives), fonctionnait depuis toutes ces années en pur gaspillage : l’eau, une fois sortie de l’endroit que l’on sait, partait directement dans les égouts. Plus de 1500 à 2500 litres d’eau potable s’échappaient ainsi quotidiennement.
C’est l’intervention d’un technicien, fin 2018, qui a permis de prendre conscience du problème. Suite à cette découverte, la municipalité a non seulement décidé d’installer un système de récupération pour éviter ce gaspillage, mais aussi de vérifier toutes les fontaines de la ville.
A quelques jours d’intervalle, on apprenait par ailleurs, dans des sphères tout à fait différentes, que
- les actionnaires du géant Bayer ont contesté avec force le rachat de Monsanto, refusant de donner leur quitus au directoire de l’entreprise. Comme l’écrit Cécile Boutelet dans Le Monde, ce « bouleversement majeur pour Bayer » montre que « la seule logique industrielle est désormais insuffisante, dans un monde où l’opinion publique, tout comme les investisseurs, est davantage sensibilisée sur les questions environnementales et sanitaires que par le passé ». « La perte de confiance dans la marque Bayer, jusqu’ici synonyme du sérieux et de la moralité de l’industrie chimique allemande de l’après-guerre, est un dégât jugé très grave par les actionnaires ».
- dans l’univers de la mode, le marché de la friperie (vêtements d’occasion) connaît une telle expansion qu’il est appelé, selon des estimations, à dépasser d’ici moins de dix ans la « fast fashion » (collections renouvelées très rapidement). Les pratiques et les mentalités évoluent rapidement – en 2018, 64% des femmes auraient déjà acheté ou seraient prêtes à acheter des produits d’occasion, contre 52% en 2017 et 45% en 2016 – et ce dans toutes les classes sociales et les tranches d’âge.
Ces trois informations peuvent sembler éloignées, et pour certaines, anecdotiques. On aurait pourtant tort de les sous-estimer en y voyant des phénomènes isolés.
Toutes disent quelque chose de l’époque, chacune à leur échelle et dans leur domaine respectif (gestion d’infrastructures publiques ; stratégie d’entreprises ; pratiques de consommation).
Elles relèvent d’un même mouvement structurel, d’une lame de fond commune, que l’on pourrait désigner par « Zeitgeist » – ce terme allemand que l’on traduit souvent par « l’esprit du temps ».
« Le Zeitgeist constitue un système d’idées, d’images et de valeurs qui, déterminant une certaine ambiance intellectuelle, culturelle, fonde les pratiques, les comportements individuels et collectifs, et inspire les créations, jusqu’à celles qui sont considérées comme les plus personnelles. Il est atmosphère, air du temps, influençant styles et modes de vie individuels, et scandant la respiration sociale » (Philippe Robert-Demontrond).
Comment caractériser ce « Zeitgeist » ? Le meilleur moyen de le cerner, de le décrire, semble être simplement de s’en référer à ses différentes manifestations.
Un exemple parmi d’autres : dans l’univers des cosmétiques, la tendance forte du moment serait « l’écobeauté », à savoir ce qui met en valeur l’aspect naturel de sa peau.
Ici comme ailleurs, le phénomène est évidemment repris si ce n’est tiré par les marques, qui y voient autant le risque de rater le train de ce nouvel « esprit du temps » qu’une nouvelle opportunité de croissance : « l’industrie, des géants aux petites marques indépendantes, a compris le changement de paradigme »,écrit la journaliste Zineb Dryef dans Le Monde. « Après avoir vendu pendant des décennies des produits pour « camoufler » boutons et autres imperfections, les marketeurs de la beauté ont revu leur vocabulaire : on parle désormais de « transparence », d’« authenticité », de « beauté intérieure », de « simplicité », de « retrouver sa vraie nature ».
Les enseignes bio ne sont d’ailleurs pas en reste : il y a quelques mois, Naturalia a ainsi lancé Naturalia Origines, nouveau « concept store » dédié à la médecine douce avec déjà quatre magasins dans Paris, qui se présente comme le « temple du bien-être 100% bio »…
Bien plus qu’une simple tendance
On pourrait voir, dans ce mouvement global, le signe d’une nouvelle mode, par nature éphémère, vouée à laisser place plus tard à d’autres tendances à l’obsolescence programmée.
Ce serait faire là un pari bien risqué. Car ce mouvement repose sur un sous-jacent qui, lui, ne risque pas de se faner de sitôt : la dégradation de l’environnement – et ce qui en est relié, comme la montée de nouveaux problèmes de santé liés aux pesticides, au plastique, aux produits transformés.
A la différence de tendances précédentes, on voit mal comment la situation pourrait s’inverser, au vu de ce qui nous attend en matière environnementale. Tout indique que ce mouvement ne fera que gagner en importance, aussi bien s’agissant du nombre de personnes qui y seront sensibles que de sa profondeur. Des préoccupations auparavant quasi-inexistantes, il y a peu encore secondaires, sont appelées à devenir demain primordiales. Des visions modérées seront amenées à gagner en radicalité. Des logiques de compromis, voire de compromission, jusqu’ici acceptées ou du moins tolérées, sont condamnées à devenir rejetées.
Des implications tentaculaires
Ce nouveau « Zeitgeist », dont les différentes manifestations sont encore souvent considérées comme sympathiques, rigolotes ou agaçantes selon les points de vue, pourrait s’avérer demain décisif dans de nombreux domaines. Prenons ici deux exemples : les marques, et les recruteurs.
Pour les marques
Il appelle les marques à de profonds changements, du moins pour celles dont les valeurs actuelles restent figées dans des logiques anciennes. Le cas récent du magazine Elle, épinglé pour l’article présenté ci-dessous, est à ce titre tout sauf anecdotique.


Pour ses dirigeants, il sera vain, plus tard, de se lamenter face à la baisse de ses ventes. Le problème sera bien plus profond, plus ancien, et donc plus difficile à surmonter. Quand un magazine (se voulant) prescripteur de tendances commence à accumuler du retard en la matière, c’est sa pérennité même qui est mise en danger.
Au-delà de « Elle », cet exemple devrait servir de contre-modèle à toutes les marques ayant l’ambition de devenir ou rester des références dans les années et décennies à venir – voire, plus simplement, de perdurer… : selon une étude récente d’Havas Paris, 87% des marques pourraient disparaître sans aucun regret de la part des Français. Ce chiffre inspire ce diagnostic sans concessions de Valérie Planchez, vice-présidente d’Havas Paris : « nous sommes allés trop loin, avons mal fait notre travail, n’avons pas créé de « fair deals » avec les consommateurs, et payons aujourd’hui la monnaie de notre pièce ».
Pour les recruteurs
« Manifeste étudiant pour un réveil écologique » : ce texte rédigé fin 2018 par des élèves de différentes grandes écoles (HEC, AgroParisTech, CentraleSupélec, Polytechnique, ENS Ulm) en collaboration avec des étudiants de « dizaines d’établissements différents », a eu un certain écho en ce début d’année. Plus de 30 000 étudiants de grandes écoles l’ont signé, avec un message principal : faire savoir aux entreprises qu’ils ne se voient postuler que dans celles « en accord avec les revendications exprimées dans le manifeste », à savoir compatibles avec les logiques écologiques.
Bien sûr, une signature à un manifeste n’engage pas à grand-chose et n’empêchera pas certains de ces étudiants de postuler en temps voulu dans des entreprises dont ils récusent aujourd’hui les pratiques.
Bien sûr, ces étudiants ne sont en rien représentatifs de l’ensemble des étudiants de France (ce qu’ils ont reconnu dès le début de leur initiative).
Mais on aurait tort, pour autant, de minorer ce mouvement, qui dépasse les seules préoccupations environnementales et touche plus globalement à l’impact des entreprises sur la société et à la question du sens.
D’abord parce qu’il est porté par une partie non-négligeable des jeunes talents que recherchent – avec de plus en plus de difficulté – les grands groupes. A Polytechnique, dont une part importante de diplômés se dirigent vers l’industrie et des postes décisionnels, plus de 600 élèves ont signé le manifeste. A Centrale, « de plus en plus de diplômés choisissent des petites structures où ils comprennent ce qu’ils font et pourquoi ils sont là [alors qu’il] y a quinze ans, 50 % d’une promotion s’orientait directement dans les grands groupes », selon le directeur de l’école.
Ensuite parce qu’il est mondial. Le même phénomène se manifeste par exemple aux Etats-Unis. Le New York Times l’a constaté récemment lors d’un événement à la prestigieuse université de Berkeley : les futurs diplômés en informatique sont de plus en plus nombreux à éviter Facebook, en dépit des 140 000 dollars annuels assortis de différents avantages en nature proposés aux ingénieurs en sortie d’école – et ce, non pas parce que le réseau est passé de mode, mais bien pour ses impacts sociétaux.
Les témoignages citées par le New York Times convergent dans le même sens : « un grand nombre de mes amis se disent qu’ils ne veulent plus travailler pour Facebook pour les questions de privacy, fake news, données personnelles, tout cela » ; « je ne crois tout simplement pas au produit parce que tout ce qu’ils font consiste à montrer plus de publicités aux gens » ; « avant, y travailler était vu comme prestigieux voire magique; maintenant, on se dit que ce n’est pas parce qu’ils font ce que les gens souhaitent que c’est positif ».
Même si les jeunes diplômés restent nombreux à y postuler, ceux-ci le font « un peu plus discrètement, expliquant à leurs amis qu’ils vont y travailler pour changer l’entreprise de l’intérieur ou qu’ils ont trouvé un poste plus éthique dans cette entreprise à la réputation devenue toxique », écrit le New York Times, qui ajoute : « le changement d’attitude se produit au-delà de Facebook. Dans la Silicon Valley, les recruteurs disent que les candidats en général posent plus de questions du type « comment puis-je éviter un projet sur lequel je suis en désaccord ? » et « comment puis-je rappeler à mes chefs la mission que s’est fixée l’entreprise ? ».
Au-delà de la Silicon Valley, de nombreux jeunes diplômés, qu’ils soient issues de formation d’ingénieurs ou de commerce, font part d’un sentiment de « dissonance cognitive » et de « perte de sens » dans leur activité professionnelle. Pour la sociologue Cécile Van de Velde, « au niveau individuel, la question posée est : s’ajuster au marché du travail, d’accord, mais jusqu’où ? Par nécessité, la plupart des jeunes diplômés acceptent de renoncer à certaines valeurs pour rester dans la course, mais ils peuvent développer alors un sentiment majeur de désajustement. Je les appelle les « loyaux critiques » : ils jouent le jeu, mais portent une critique radicale du système, depuis l’intérieur ».
Ces considérations sont évidemment en soi déjà un luxe, à l’heure où l’objectif de nombreux jeunes est plus simplement de trouver un emploi, ou un travail qui serait rémunéré de façon correcte. De même, il est évident que le besoin de sens n’a pas émergé en 2018 ou 2019 : il n’est pas nouveau en soi.
Mais sa montée est indéniable et n’en est probablement qu’à ses débuts. Fait inédit : à l’ENA, la dernière promotion a débattu sérieusement de la possibilité de s’appeler « Urgence climatique », même si ce nom a finalement été écarté en « finale » après huit heures de débat (…partie remise ?).
Cécile Van de Velde confirme qu’elle « constate que le sentiment d’urgence face à la catastrophe écologique est de plus en plus prégnant. J’ai pu [le] voir monter et se diffuser, au fil de mes recherches sur la colère sociale. En 2012, la colère des jeunes diplômés était principalement structurée par les thématiques sociales et économiques. Aujourd’hui, le malaise est plus existentiel, plus global. Il porte davantage sur la question de la marche du monde et de l’humanité menacée. » Et si ces questionnements restent en grande partie portés par des classes sociales qui ne sont pas en difficulté, elle note que « chez cette jeunesse bien informée, bien formée et qui a des ressources, il y a un refus de transmission du système ».
Elle confirme également la dimension internationale et générationnelle de ce mouvement : « On voit dans les enquêtes internationales sur les valeurs que la conscience environnementale et la demande d’éthique politique sont deux revendications qui distinguent fortement les jeunes générations montantes. Non pas que ces revendications n’existent pas chez les autres, mais elles sont portées à l’extrême par ces jeunes générations. ».
Elle relie cette situation à « une inversion de la transmission entre générations » que l’anthropologue américaine Margaret Mead avait annoncé dès 1968 dans son ouvrage « Le Fossé des générations » : « au lieu d’être descendante – des parents vers les enfants –, cette transmission pouvait devenir ascendante. C’est cette forme d’inversion générationnelle qui est à l’œuvre aujourd’hui sur les questions climatiques et environnementales. »
Les normes sociales comme moteur du changement
Il y a encore peu, beaucoup voyaient dans la vague « startups » l’émergence d’une tendance lourde : l’arrivée d’une génération entrepreneurs, prêts à « uberiser » des pans entiers d’une économie traditionnelle jugée obsolète, et visant l’hypercroissance à tout prix. On sent pourtant déjà aujourd’hui en France que le vocable « startup nation » a commencé à se faner. La « disruption » sent le sapin : lorsqu’elle n’a pas mauvaise presse pour ses impacts sociaux, elle est tournée en ridicule, vue comme caricature d’un « nouveau monde » qui sonne déjà assez ancien.
Les startups sont évidemment encore (très) vivantes, et l’entrepreneuriat est bien sûr très loin de se résumer aux startups ; le propos est simplement de dire que celles-ci ne sont plus le modèle qu’elles ont pu représenter, il y a encore peu, aux yeux de certains.
Or cette question du modèle est clef.
« L’esprit du temps » dont il est question touche éminemment aux normes sociales, et en particulier à ce qui est valorisé et à ce qui devient à l’inverse mal vu.
A ce titre, l’exemple de la « honte de prendre l’avion » qui se développe en Suède et qui conduit un nombre croissant de voyageurs à préférer le train pour réduire leur empreinte carbone, est tout sauf anecdotique : c’est un vrai signal faible, dont la portée est sans doute encore sous-estimée.
Le phénomène, qui a son propre mot en suédois (« flygskam »), semble sérieux : d’ores et déjà, plusieurs lignes intérieures ont vu leur nombre de passagers diminuer, tandis que les trajets en train – et notamment les trains de nuit – entre les principales villes suédoises battent des records de fréquentation.
Ce type de pratiques est appelé à s’amplifier dans des domaines très divers, non pas uniquement en raison d’un souci accru de l’environnement, mais aussi, plus prosaïquement, en raison de l’image que l’on souhaite renvoyer.
En 2013, le PDG de la société Opower racontait qu’un groupe d’étudiants avait testé les trois messages suivants pour encourager les gens à économiser de l’énergie : « vous pouvez économiser 54 dollars ce mois-ci » ; « vous pouvez sauver la planète » ; « vous pouvez être un bon citoyen ». Aucun n’a fonctionné. Un quatrième message a alors été testé : « vos voisins font mieux que vous ». Le résultat s’est avéré « miraculeux : quand les gens découvraient que ¾ de leurs voisins avaient éteint l’air conditionné, ils l’éteignaient aussi ».
Les changements de comportements ne se feront pas (seulement) par des logiques d’incitation économique ou de contraintes. Ils seront favorisés en large partie par la pression sociale.
Dans le cas du transport en avion (l’un des principaux contributeurs d’émission de CO2), la prise de conscience progressive des ordres de grandeur liés aux émissions de CO2 devrait conduire, par exemple, à remettre en cause progressivement la mode des escapades le week-end en Europe, jusqu’alors tirées par les prix spectaculairement bas des compagnies low-cost.
C’est d’ailleurs ce qu’indique officiellement l’ADEME dans son scénario 2050 pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement en matière écologique : « Dans le domaine des loisirs, les voyages en avion ne seront pas proscrits, mais ils devront être globalement plus rares, en privilégiant les longs séjours plutôt que la fréquence des escapades ».
En se plaçant en 2050, l’ADEME écrit : « la politique climatique a amené à transformer les pratiques touristiques. La nouvelle fiscalité sur le kérosène a contribué à modifier les habitudes: on prend toujours l’avion pour voyager loin, mais moins souvent et plus longtemps. Les entreprises proposent maintenant à leurs salariés la possibilité de cumuler trois mois de congés payés pour faire des grands voyages ».
Autrement dit, « voyager à longue distance en avion est envisageable à condition que cet usage soit réparti dans le temps. » Pour ce faire, il sera nécessaire de « modifier les comportements liés à l’aspiration aux voyages en avion avec le développement du tourisme sur longue distance. L’objectif est de mettre en place des règles collectives qui permettent un tourisme de long séjour ».
Le domaine des loisirs n’est pas le seul concerné par le changement de ces pratiques puisqu’une large partie des trajets en avion sont liés à des déplacements professionnels. Là encore, les normes sociales sont appelées à jouer un rôle important.
Exemple parmi d’autres : aujourd’hui, les formulaires d’évaluation des chercheurs du CNRS demandent le « nombre de conférences internationales » où les chercheurs ont été invités, ce qui encourage en creux le maximum de déplacements à l’étranger. S’il est évidemment compréhensible, et même souhaitable, qu’un chercheur soit amené à présenter ses travaux à l’international, on peut se demander si les déplacements sont à chaque fois justifiés et si des substituts ne seraient pas, parfois, envisageables.
Cet exemple n’est pas le plus représentatif, il faut le reconnaître, et ce d’autant plus que la recherche joue bien sûr un rôle essentiel dans la lutte contre le désastre écologique ; mais il montre, quitte à déplaire, qu’aucun domaine ne serait être tenu à l’écart de ces questionnements.
Quelles conséquences ?
Les implications sont très larges et appelées à se diffuser dans les différents interstices de la société. Comme toujours, elles seront vues comme des évidences a posteriori. Comme toujours, elles sont sous-estimées a priori.
La notion de luxe, par exemple, est déjà en (r)évolution. C’est ce qu’écrit l’essayiste Gaspard Koenig dans un texte récent : « Dans sa célèbre controverse avec Rousseau, Voltaire définissait le luxe comme « tout ce qui est au-delà du nécessaire », s’inscrivant dans « une suite naturelle des progrès de l’espèce humaine ». En cette époque d’abondance matérielle et d’achats grégaires, que trouve-t-on de rare et de superflu « au-delà du nécessaire » ? Le silence et la frugalité. (…)
A l’ère de la massification des transports, le luxe consiste à retrouver une forme de sobriété et de tranquillité dans des environnements à taille humaine.On ne compte plus les sites de voyage qui promettent « l’authenticité » . En Roumanie justement, aux pieds des Carpates, le prince Charles a rénové des maisons traditionnelles où vient séjourner la gentry londonienne. Le dernier chic est de faire son propre pain.
Le documentaire de Benjamin Carle, « Sandwich », enquêtait sur cette mode du Do It Yourself : un repas de luxe ne consiste plus à manger du caviar mais à partager le sandwich que l’on a fait entièrement soi-même, en faisant pousser les tomates et en récoltant le blé. »
Pour reprendre l’exemple de l’avion, c’est tout l’univers du tourisme qui sera amené à évoluer. Certains acteurs commencent déjà à l’anticiper. Le PDG de Voyageurs du monde, Jean-François Rial, dit aujourd’hui s’interdire de proposer certains voyages « inacceptables » : « Les long-courriers en dessous de cinq nuits, les allers-retours en Europe dans la journée, c’est non ! ».
D’autres acteurs ne souhaitent pas être dans ce type de compromis où l’avion a encore une place centrale. Ils s’inscrivent dans la tendance du tourisme durable, sobre, qui, là encore, n’a rien d’une mode et ne devrait faire que monter en puissance. Pour Guillaume Cromer, directeur du cabinet ID-Tourism, « les premiers touristes de demain seront intrarégionaux », ce qui implique de « construire de nouveaux imaginaires sur l’ailleurs, et de dépayser grâce à des hébergements atypiques ». Du reste, comme l’écrit Gaspard Koenig, « les Millennials branchés ne jurent plus que par le « tourisme expérientiel », préférant vivre chez l’habitant plutôt que d’être parqués dans des suites anonymes et climatisées ».
Evidemment, dans tout ce mouvement, il faut distinguer les modérés et les radicaux ; les militants et les hésitants ; les pionniers et les suiveurs : bref, tout un spectre.
Evidemment, comme dit précédemment, ces questionnements restent aujourd’hui un certain luxe ; il est plus difficile de se préoccuper de la fin du monde lorsqu’on a du mal à finir le mois…
Pour autant, on voit mal l’impact de ce « nouveau paradigme » rester circonscrit.
Dans l’univers du marketing, et donc de la consommation en général, les marques restent par exemple souvent frileuses à l’idée d’investir le terrain politique, au sens vie de la cité. Or les consommateurs attendent de plus en plus des marques qu’elles s’engagent, qu’elles défendent leurs convictions, qu’elles « prennent position sur des sujets de société clivants » pour reprendre les mots de David Nguyen de l’Ifop, et plus encore : qu’elles soient avant-gardistes en la matière.
Les marques les plus fortes ne sont pas consensuelles. Seth Godin, « gourou » du marketing, l’exprime ainsi : « Cela n’a plus de sens de vouloir plaire à tout le monde. Plus aucun produit ou service ne peut avoir cette ambition. Les marques doivent concentrer leurs efforts sur un petit nombre de clients, et susciter leur engagement. Et pour cela, elles ne doivent plus hésiter à être avant-gardistes, à prendre des risques, à oser les extrêmes ! »
Il cite l’exemple de la marque Patagonia : « eux s’engagent pour l’écologie, et n’hésitent pas à aller toujours plus loin. Mais ces choix, parfois radicaux, donnent du sens à leur message et donc à leurs produits. »
C’est l’exemple, aussi, de la marque d’électronique américaine Sonos qui a fermé l’an dernier le temps d’une journée son magasin de New York pour afficher son soutien à la neutralité du net.
La politique ne sera pas laissée de côté
« Les jeunes, à mesure de leur prise de conscience politique, seront beaucoup plus radicaux que leurs parents, tout simplement parce qu’ils n’auront plus d’autre choix » – Phil McDuff dans The Guardian
En matière environnementale, les nouvelles générations sont vouées à être plus radicales. Les notions de développement durable et croissance verte semblent déjà vieillies. La force du nouveau mouvement « Extinction Rebellion » au Royaume-Uni, qui prône la désobéissance civile non-violente contre l’inaction climatique, en est un signe révélateur. « Extinction Rebellion is leading a new, youthful politics that will change Britain » annonçait d’ailleurs fin avril un chroniqueur du Guardian.
Au-delà des seules pratiques de consommation, le terrain politique ne sera donc pas laissé de côté. On sous-estime encore l’arrivée à l’âge de voter de cette nouvelle génération. Il est d’ailleurs permis de s’interroger sur la part d’électeurs de Mélenchon ayant voté pour lui en 2017 non pas (spécialement) pour son positionnement d’extrême gauche mais pour son radicalisme écologique et institutionnel. Dans quelle mesure son score de presque 20% (à 1,7 point de Marine Le Pen et donc du second tour) a-t-il été dû à ces enjeux ?
Ces questions doivent nous interroger sur le potentiel de l’écologie comme force politique – qui n’a jusqu’ici jamais franchement connu le succès en France. Que manque-t-il pour que celle-ci réussisse ? Peut-être avant tout la figure d’un leader capable de rassembler bien au-delà de son camp et de susciter une adhésion forte sur sa personne, à partir d’un terreau d’idées commençant à devenir massivement partagées.
Si tel est le cas, alors nous pourrions être politiquement dans un état métastable, comme on l’appelle en physique – cet état qui se manifeste lorsque de l’eau en-dessous de 0°C reste provisoirement liquide. Il suffit alors d’un micro-évènement pour déclencher brutalement un changement de phase qui aurait pu se produire plus tôt (ou plus tard). L’émergence d’une personnalité représentant l’écologie et capable de rassembler pourrait constituer ce facteur de déclenchement. Y a-t-il aujourd’hui une personnalité en France capable de remplir ce rôle ?
Une chose est sûre : à défaut d’engagements forts, le greenwashing sera de moins en moins acceptés par les individus, que ceux-ci soient considérés comme consommateurs, demandeurs d’emplois ou électeurs. Si cela ne concerne pas (encore ?) l’ensemble des citoyens – il ne s’agit pas de les homogénéiser artificiellement -, il n’est plus à prouver que les mouvements émergents commencent toujours par des « early-adopters ».
Pour les marques à la recherche de nouveaux consommateurs, pour les entreprises à la recherche de nouveaux talents, pour les partis politiques à la recherche d’électeurs, le constat est donc le même : des changements cosmétiques ou de pure communication ne seront non seulement pas suffisants – la ficelle serait trop grosse – mais seront, surtout, dangereux, car porteur de risques de décrédibilisation forte. A charge à chaque acteur d’en tirer les conséquences.